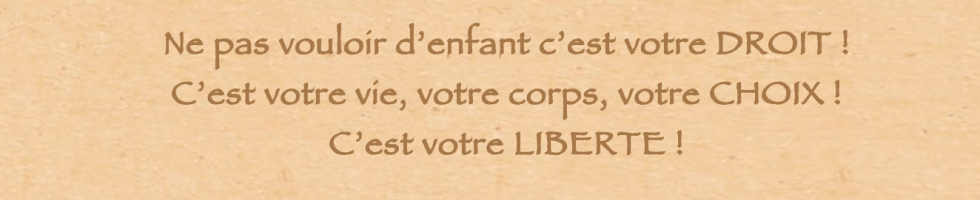Ce qui est certain, à première vue, c’est que, en France, les femmes sans enfant n’ont pas plus d’étiquette hostile que celles qui en ont et qui reprennent rapidement un travail à plein temps !!
Seuls quelques ‘conservateurs’ osent encore y voir un problème identitaire. Un bémol cependant : « si l’identité des femmes d’aujourd’hui n’est plus fondée exclusivement sur la maternité, l’enfantement, on constate que les femmes d’aujourd’hui ont plus de mal à se livrer sur le sujet que les femmes interrogées il y a 30 ans ». C’est en tout cas, le constat d’Edith Vallée. Les femmes de l’après-révolution sexuelle, portées par cet enthousiasme, cet éclatement des valeurs autour de la sexualité, ont plus facilement ouvert leur porte que celles des femmes du début des années 2000. « Non pas qu’elles cherchent à se cacher ou à éviter le sujet, mais les faire s’exprimer sur cet aspect délicat de leur vie de femme est apparemment moins simple qu’on ne pourrait le croire ».
Une Française sur dix n’aura pas d’enfant au terme de sa vie. Pour certaines, on l’a vu, ce n’est pas un vrai choix. Elles estiment ne pas avoir trouvé le bon compagnon, ont laissé le temps filer ou vivent au sein d’un couple infertile et n’ont pas pu ou voulu adopter. Les femmes qui décident de ne pas devenir mère seraient donc très peu nombreuses.
« Il existe une pression collective qui incite les couples à avoir des enfants », estime Arnaud Régnier-Loilier[1]. « Le non-désir d’enfant semble en effet marginal dans une France qui affiche un taux de fécondité record en Europe (deux enfants par femme) et un nombre de naissances croissant (830 900 bébés en 2006). Les femmes sans enfants sont généralement assez diplômées. Le désir d’enfant s’impose plus vite pour les femmes qui peinent à s’inscrire sur le marché du travail. La maternité leur permet d’acquérir un statut, celui de mère de famille. Les femmes cadres ont d’ailleurs moins d’enfants que les autres ».
Mais pourquoi ne pas en vouloir du tout ?
« Pour bien profiter de leur vie de couple – voire pour ne pas le mettre en danger – ou pour ne pas entraver leur carrière » répond le chercheur.
Quand elle dit « Le ‘non-désir d’enfant’ n’existe pas, je n’y crois pas. Toutes les petites filles disent que quand elles seront grandes, elles auront des bébés. Ensuite, beaucoup, pour des raisons diverses, liées à leur carrière, à leur compagnon (pas le bon, pas au bon moment) laissent passer le temps, mais ensuite elles regrettent », Monique Bydlowski ouvre un autre débat.
Je ne partage pas son avis sur ce dernier point : les femmes sans enfant de plus de cinquante ans que j’ai interviewées, m’ont dit avoir une vie bien remplie, se sentir libres, avoir pratiqué des IVG justement pour ne pas assumer la charge d’un enfant, et surtout, ne rien regretter.
M. Bydlowski appuie son propos : « toute la douleur du monde se déverse dans les consultations pour infertilité ». La tentation est grande, ici, d’opposer les femmes qui peuvent avoir des enfants à celles qui ne le peuvent pas. Il est bien normal que ces dernières souffrent si elles désirent un enfant. Mais entre celles qui ne veulent absolument pas d’enfant, et qui s’arrangent pour ne pas en avoir, et celles qui en veulent malgré leur infertilité, il y a toutes celles pour qui la vie se charge de mettre son petit grain de sel perturbateur.
Ne généralisons pas, une fois encore. Il y a des femmes qui regrettent peut-être de ne pas en avoir, comme il y a des femmes qui, avec quelques années de recul, finissent pas regretter d’avoir eu recours à l’IVG. Mais il y en a qui ne regrettent ni l’un, ni l’autre.
Édith Vallée évoque, elle, la passion qui remplit une vie (amour fusionnel, engagement artistique, humanitaire), la peur de transmettre un mal-être, le manque d’opportunités…
« Mais dire que l’on n’a pas eu le temps de faire un enfant ou que l’on n’a pas trouvé l’homme idéal révèle un non-désir d’enfant non assumé. Une vérité trop difficile à admettre dans notre société », conclut la psychologue.
Je ne rejoins pas les conclusions d’Edith Vallée, qui suggèrent qu’aucune femme n’assume vraiment le fait qu’elle n’ait pas d’enfant. Certaines femmes n’ont pas d’enfant car elles n’en ont réellement jamais voulu, et d’autres n’auraient pas été contre l’idée d’en avoir à conditions de connaître cet homme idéal. Estimer ne pas l’avoir rencontré est à mon sens une bonne raison de ne pas avoir d’enfant, ou disons, une raison nécessaire et suffisante.
En matière de maternité, la réponse de la société face aux femmes sans enfant dépend de la culture, d’une part, et est relativement liée à la manière dont la femme annonce qu’elle n’a pas d’enfant, d’autre part : si elle affiche ouvertement une irritation face aux enfants, les mères ayant du mal à entendre cela, risquent de se sentir agressées et de « contre-attaquer ». En restant discrète sur ses motifs, elle laisse planer un doute : elle a peut-être un problème de stérilité, elle n’a pas (encore) rencontré l’homme qui convient, ou elle attend d’avoir une situation plus stable. Si elle annonce qu’elle aime malgré tout les enfants, la pilule passe encore mieux, sans jeux de mots.
Pour clore ce paragraphe, il ne s’agit pas de prôner la non-maternité, pas plus que la maternité d’ailleurs. À chaque femme son destin, réellement « choisi » ou non, parfaitement assumé ou non.
Entre les femmes qui veulent un enfant à tout prix, quitte à passer par le corps médical, une mère porteuse ou l’adoption, et celles qui préfèreraient se faire ligaturer pour être certaines de ne jamais tomber enceinte, il y a tout un panel de situations toutes aussi singulières les unes que les autres, empreintes de toutes les ambivalences liées à la maternité. L’essentiel pour une femme ne souhaitant pas devenir mère est de se mettre à l’écoute des nombreux fondements individuels qui la motivent. Si ce choix est définitif, il sort de la norme, certes, mais au fond, pas plus que celui d’une grossesse désirée à seize ans.
[1] Sociologue et chercheur à l’Ined (Institut national d’études démographiques)